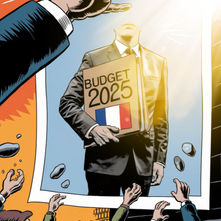L'HISTOIRE DES NIPPO-BRÉSILIENS
Suite aux guerres de l’opium entre la Grande-Bretagne et la Chine* (1839 – 1856, peu avant l’ère Meiji) et à la défaite chinoise, déstabilisant grandement son régime politique, les autorités japonaises souhaitent éviter au Japon de connaître le même sort en côtoyant l’Occident. Une politique isolationniste, dite « Sakoku » (« fermeture du pays »,) fut imposée par le shogunat Tokugawa de 1633 à 1853, empêchant toute immigration, afin de protéger l’île.
Cependant le Japon est contraint au 19ème siècle (particulièrement pour des raisons économiques, le pays s’appauvrissant) de rouvrir ses ports aux Occidentaux souhaitant commercer. Les Etats-Unis avaient débuté une expédition militaire vers l’archipel en 1853, pour entamer des relations économiques et diplomatiques. Ainsi des nations d’Amérique (le Pérou, le Mexique, l’Argentine et le Brésil inclus) se rapprochent de l’Asie de l’Est. C’est alors la seconde fois dans l’histoire que le monde lusophone et nippon se côtoient, la première fois étant l’épisode des missionnaires jésuites portugais au XVIe siècle, ayant échoués à convertir l’île.
Ce second contact, responsable du début de l’’influence occidentale sur l’archipel, entrainera le passage du Japon à l’ère Meiji (1868 – 1912). Ere caractérisée par un soucis constant de modernisation et d’industrialisation, afin d’entre autres, pouvoir prouver à l’Occident que le Japon est leur égal. Le Japon mettra alors en place un Etat-nation japonais, avec une Constitution, un code civil et plusieurs institutions politiques et juridiques, rattrapant son « retard ».
L’idée d’immigrer vers de meilleurs horizons vient alors à certains paysans. En effet, ces derniers représentent près de 80 % de la société, et voient le manque de terres et leur endettement leur empêcher de fructifier économiquement.
Cependant, les Japonais n’avaient toujours pas le droit d’émigrer, ou du moins d’émigrer librement. Le gouvernement ne voulait pas ternir l’image du Japon en laissant ses citoyens pauvres partir à l’étranger pour travailler contre de basses compensations.
Malgré tout, à partir de 1868, les autorités permettent à certains Japonais d’émigrer à Hawaii, fraichement devenue Etat-Unienne, sous quelques strictes conditions, car cela était toujours légalement interdit : ils devaient quitter l’archipel avec un contrat de trois ans et revenir impérativement ensuite.
Cette première migration a déclenché des mouvements anti-asiatiques à Hawaii. Les États-Unis et le Japon se sont alors accordés afin de limiter les flux migratoires en 1924 avec l' « Immigration Act of 1924** ».
Parallèlement à la première guerre Sino-japonaise*** de 1894 à 1895 (que le Japon a remporté), une loi de protection des émigrés a été mise en place au Japon, légalisant officiellement l’émigration en reconnaissant le statut juridique d'émigré. Cela avait en creux de mettre un point au marché noir s’étant mit en place au sein duquel des Japonais émigraient par des réseaux de passeurs.
Mais pourquoi donc les Japonais se sont-ils dirigés vers le Brésil ?
Cela s’explique par l’«Immigration Act of 1924 », qui redirige les flux d’ immigrés asiatiques vers des pays d’Amérique latine, et surtout le Brésil.
Celui-ci manquait grandement en main d’œuvre depuis l’abolition de l’esclavage en 1888. En 1892, une loi brésilienne est donc acceptée pour autoriser immigrés Japonais à s’installer au Brésil.
Les premiers immigrés, surnommés dekasegi (« ceux qui sortent pour gagner de l’argent »), quittent leur archipel 28 avril 1908 à bord du Kasato Maru. Et arrivent en juin 1908 dans l’État de São Paulo (la demande de main d’oeuvre y était très importante). Un traité d’amitié entre le Japon et le Brésil est signé en 1895.
Durant la période allant du 28 avril 1908 au 22 juin 1941 (l’émigration est interrompue du fait de la guerre), 188 996 Japonais ont choisi d’émigrer au Brésil.
Une fois installés, ceux-ci trouvent du travail dans les plantations de café, «l’or noir» de l’époque, de cannes à sucre, de maïs, de soja, de blé, de tomate ou de manioc. D’autres travaillent dans le secteur industriel ou commerciale.
Malgré ce rapprochement, l’intégration des Japonais a été moindre, celle ci ne s’étant que peu mélangée à la population brésilienne (de grands quartiers étaient d’ailleurs composés exclusivement de Japonais). Cette mise à distance s’explique par le fait que les immigrés japonais comptaient revenir le plus vite possible dans leur patrie.
De juin 1941 à la fin de la guerre, l’émigration n’est plus possible pour les Japonais.
Elle ne reprendra qu’en 1970, lorsqu’une deuxième génération d'émigrés japonais s’installe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Brésil s’est opposé aux puissances de l’Axe (l’Allemagne, l’Italie et le Japon), l’arrivée soudaine des Japonais ravive alors une xénophobie anti-asiatique du peuple brésilien. Ce nouveau flux a cependant pu avoir accès à des emplois relativement qualifiés au sein de la société brésilienne (enseignants, ingénieurs, médecins, etc.).
Le Japon, quelques dizaines d’années plus tard, connaît une pénurie de main-d’œuvre, notamment dans les usines japonaises et devra donc encourager le retour de ses émigrés. Pour cela, il revisitera en 1990 la loi-cadre sur l’immigration qui jusque là n'autorisait pas l'immigration non qualifiée. Le gouvernement japonais met donc en place une exception, pour les Nippo-Brésiliens particulièrement, leur autorisant un visa facilement accessible et de longue durée, « teijusha », délivré spécifiquement aux descendants de Japonais de deuxième et troisième générations.
En raison de la crise économique des années 1990 traversée par le Brésil, les Nippo-Brésiliens émigrent massivement au Japon pour devenir à la fin du XXe siècle la troisième communauté étrangère du Japon (après les Coréens et les Chinois). En 1988, ils étaient seulement 4 000 Brésiliens au Japon ; en 2000, 254 000 ; et en 2006, 310 000.
Suite de la faillite de la banque des frères Lehman de 2008, le monde entier subit une grave crise financière. L’économie japonaise est durement frappée : de très nombreux Brésiliensse retrouvent subitement sans emploi et parfois sans logement. 50 000 Brésiliens repartiront au Brésil de leur plein gré.
Plus de 2 millions de Nippo-Brésiliens, sont répartit actuellement entre le Brésil et le Japon. Le e Brésil compte lui sur son sol la grande majorité, environ deux millions de personnes d'origine japonaise, selon le ministère des affaires étrangères japonais (ce qui en fait la première communauté japonaise au monde, en dehors du Japon).
Aujourd’hui les Nippo-Brésiliens vivant au Japon sont cependant moins nombreux : ils sont la 5eme minorité au japon , les 4 premier étant des pays asiatiques voisins (le premier étant la Chine). Parmi tous les citoyens japonais d’origine étrangère, les Nippo-Brésiliens représentent 0,17 % de la population japonaise dans son ensemble, autrement dit 202 000.
Quel est désormais le sort de ces derniers ?
Aujourd'hui, les deux pays demeurent proches diplomatiquement. Par exemple en 2017, une Japan House a été ouverte au Brésil à Sao Paulo, un centre culturel mettant le Japon à l'honneur. Cependant au sein même des populations, les opinions varient.
D’après un sondage effectué en 2013 par le BBC, 71% des Brésiliens avaient un point de vue positif sur l’influence japonaise, second meilleur score derrière l’Indonésie. De plus, seulement 10% des personnes interrogées voyaient d’un mauvais œil l’influence nippone sur le Brésil. Les Japonais conservent une image de réussite sociale voire de « minorité modèle ».
Cette sympathie n’est malheureusement pas réciproque de la part des Japonais. L’archipel connaît, comme une majorité de pays de nos jours, une forte hausse de sectateur de l’extrême droite. Ce parti se nomme «sanseito» au Japon, et est celui le plus adopté par les nouvelles générations: selon un sondage de asahi shimbun, un journal quotidien japonais, 71% des 30ans ou moins sont favorable au sanseito (à noter que pour les seniors, la statistique est inverse, car seulement 29% y adhère!)
Face à l’augmentation du nombre d’immigrés au Japon, et aux discours alarmistes du parti sanseito, promouvant le concept d’une «race pure japonaise étant souillée», le peuple tend à être hostile aux Nippo-Brésiliens, qu’ils ne considèrent pas comme leur égal.
Cette hostilité chez les plus jeunes se remarque par ailleurs dans les statistiques d’ijime (une forme d’harcèlement scolaire) envers les minorités: sur tous les élèves, japonais d’origine inclus, le ijime ne touche de 5,8%, mais 68 % des enfants étrangers, tout particulièrement Chinois, Coréens et Brésiliens, disent subir de l’harcèlement lié a leur ethnie. Pour leur famille, la situation des immigrés est assez précaire, avec peu de réinsertion.
C’est donc ainsi que se conclut plus de cent-cinquantes ans d’histoire commune entre le Brésil et le Japon, faite de flux allant et revenant sans-cesse et formant une communauté à la culture hybride: les Nippo-Brésiliens.
Joanna
Sources :
- Guerres de l’opium – Histoire
- 26 mai 1924 : avec le vote de l'« Immigration Act », les États-Unis entérinent l’eugénisme racial - L'Humanité
- Première guerre sino-japonaise — Wikipédia